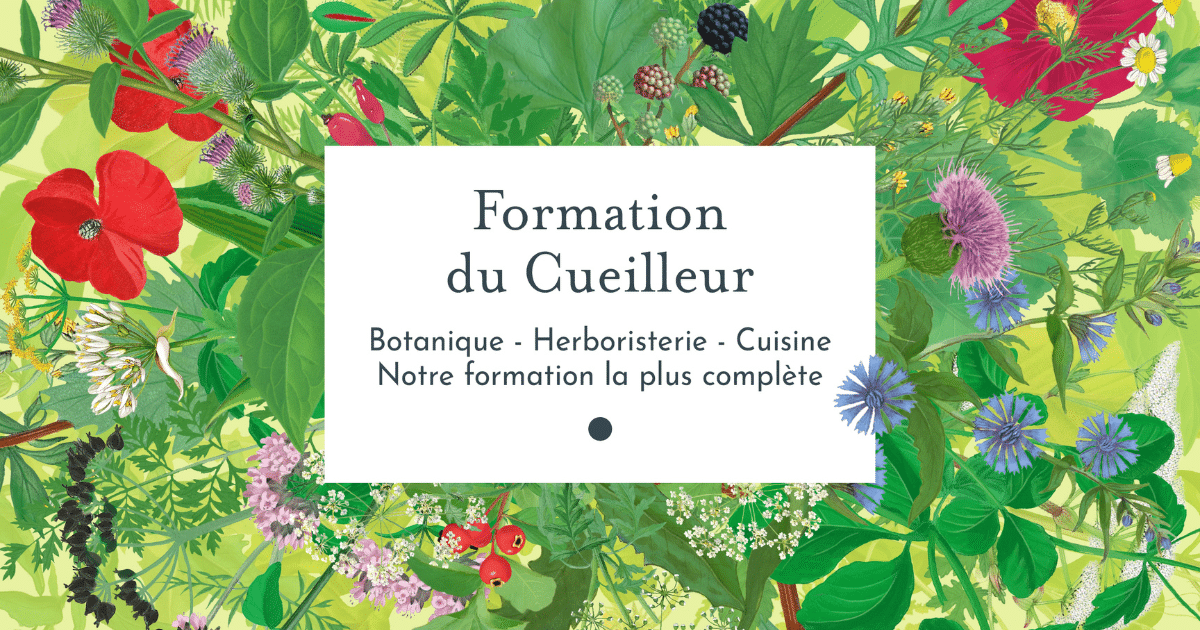Nous avons sélectionné 5 plantes sauvages comestibles et médicinales à cueillir au mois de mai : le sureau noir, l’aubépine, la prêle des champs, la stellaire commune et le coquelicot.
Vous pourrez les trouver lors de vos cueillettes printanières et elles sauront soulager certains maux ou ravir vos papilles ! Parce que chaque cueillette est une aventure, munissez-vous de votre couteau de cueillette, de votre panier et partez à la découverte des plantes sauvages !
Le sureau noir (Sambucus nigra)
Le sureau noir, (Sambucus nigra) est l’un des grands plaisirs de la cueillette de printemps. Il commence à fleurir dès le mois d’avril, parfois jusqu’en juin selon les régions. Cet arbrisseau se reconnaît facilement : ses feuilles sont composées de plusieurs folioles (généralement cinq), son bois est souple, ses troncs souvent multiples, et son odeur rappelle étonnamment celle de la cacahuète grillée.
Les fleurs, très aromatiques, sont la partie la plus connue et appréciée. On en fait de délicieux sirops, mais aussi des beignets : il suffit de tremper une inflorescence dans une pâte, de la frire, puis de la rouler dans le sucre. Une gourmandise à savourer directement à l’arbre.
Les fruits, eux, arrivent dès juillet ou août. S’ils sont comestibles cuits, en confiture, en gelée ou en sirop, ces fruits au goût proche de la mûre doivent être consommés avec précaution à l’état cru : en grande quantité, ils peuvent être laxatifs, voire provoquer des nausées. Certains les digèrent mieux que d’autres, mais la cuisson élimine les risques.
Côté médicinal, le sureau noir est réputé pour ses vertus contre les premiers symptômes du rhume. On utilise les fleurs en infusion.
Et pas d’inquiétude pour l’identification : tant qu’il y a du bois, il ne peut s’agir du sureau yèble (Sambucus ebulus), toxique, qui est une plante herbacée sans tronc ligneux, et qui ne dépasse guère 1,50 m. Le sureau noir, lui, pousse parfois en arbre, en arbuste ou en arbrisseau ramifié.
L’aubépine (Crataegus monogyna)
En avril ou mai, les haies s’illuminent des fleurs blanches de l’aubépine (Crataegus monogyna), un arbuste épineux et robuste, emblématique du printemps. Ses feuilles profondément lobées, ses fleurs blanches à cinq pétales libres, et ses épines acérées la rendent facilement reconnaissable. Elle est souvent confondue avec l’épine noire (le prunellier), mais son écorce plus claire et ses feuilles lobées permettent de les différencier. Très mellifère, l’aubépine est une plante précieuse pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ce qui en fait une excellente candidate pour les haies champêtres à replanter.
La récolte se fait en avril ou mai, au stade des boutons floraux ou au début de la floraison, en prenant les inflorescences avec quelques feuilles. À ce stade, les fleurs sont bien fraîches, riches en principes actifs et en arômes. Leur parfum discret se révèle pleinement en infusion, en sirop, en vin aromatisé ou même en pâtisserie. Le vin d’aubépine, doux et floral, est particulièrement apprécié.
Les fruits, rouges et charnus, arrivent à partir de septembre. Riches en antioxydants, ils se cuisinent en compotes, sirops ou confitures, seuls ou mélangés à d’autres fruits. Ils partagent certaines molécules actives avec les fleurs, ce qui permet de combiner les deux pour bénéficier de leurs bienfaits toute l’année.
Côté santé, l’aubépine est reconnue pour son action régulatrice sur le cœur et le système nerveux. En infusion ou en alcoolature, fleurs et fruits sont traditionnellement utilisés pour apaiser les palpitations, les troubles légers du rythme cardiaque, les sensations d’essoufflement ou encore l’anxiété et les troubles du sommeil. Elle est précieuse pour accompagner les petits déséquilibres, mais en cas de problème cardiaque, il est essentiel d’en parler à son médecin.
À la fois belle, utile et médicinale, l’aubépine est une plante généreuse qui mérite sa place dans nos paysages comme dans nos tisanes.
La prêle des champs (Equisetum arvense)
La prêle des champs (Equisetum arvense) est une plante très commune, surtout intéressante pour ses propriétés médicinales, bien que ses jeunes tiges fertiles soient comestibles au tout début du printemps. Sa tige stérile, riche en minéraux et en silicium, est utilisée traditionnellement pour ses effets reminéralisants et anti-inflammatoires, notamment pour les douleurs articulaires (arthrite, arthrose, rhumatismes). Aujourd’hui, elle reconnue contre les petites plaies superficielles de la peau et comme diurétique contre les troubles urinaires mineurs.
Pour l’identifier correctement et éviter de la confondre avec des prêles toxiques comme la prêle des marais, il faut vérifier quelques détails techniques : notamment que le premier article des rameaux du bas de la tige est égal ou plus long que la gaine adjacente, ou encore que la tige est ramifiée et présente des cannelures à deux angles.
Elle s’utilise en infusion, jusqu’à 12 g par jour. La grande prêle, à tige blanche et plus épaisse, est déconseillée. Même la prêle des champs doit être consommée avec modération.
La stellaire commune (Stellaria media)
La stellaire commune (Stellaria media), aussi appelée mouron des oiseaux ou mouron blanc, une petite plante comestible de la famille des Caryophyllacées, comme la saponaire ou les silènes. C’est une plante facile à reconnaître.
Ses feuilles sont opposées, disposées deux par deux sur la tige, et à leur insertion on remarque souvent un petit renflement sur la tige. Une ligne unique de poils court le long de la tige.
Ses fleurs blanches rappellent une étoile : elles ont cinq pétales très profondément échancrés, ce qui donne l’impression qu’il y en a dix, et cinq sépales de même longueur que les pétales. Le fruit est une petite capsule qui s’ouvre par le haut pour libérer les graines.
On peut manger toute la plante : crue en salade avec un goût doux, un peu noisetté, ou cuite comme des épinards, en poêlée ou en velouté.
Le coquelicot (Papaver rhoeas)
Le coquelicot (Papaver rhoeas), cette jolie annuelle ou bisannuelle, aux fleurs rouges emblématiques, se trouve surtout en fleur au mois de mai. Mais ses jeunes feuilles, parfois présentes tout l’hiver, se développent surtout dès mars-avril, souvent en rosettes, sur des terrains récemment retournés.
Plusieurs parties du coquelicot sont comestibles. Les jeunes feuilles peuvent être consommées, mais avec modération, car elles contiennent des alcaloïdes légèrement toxiques si elles sont ingérées en trop grande quantité. On peut aussi cueillir les boutons floraux et les conserver dans du vinaigre, pour obtenir des sortes de « câpres » originales. Les pétales peuvent être utilisés pour décorer des plats ou pour réaliser des sirops d’un rouge éclatant. Enfin, une fois les capsules bien sèches, on peut récupérer les petites graines, qui servent en cuisine ou en décoration.
Sur le plan médicinal, seuls les pétales sont utilisés. Ils auraient des propriétés sédatives douces, idéales pour favoriser le sommeil et apaiser le stress. Ils seraient également antitussifs, particulièrement efficaces contre les toux nerveuses. On les emploie en infusion ou en sirop, selon les besoins.
Pour aller plus loin
Nous vous rappelons que la cueillette sauvage comporte des risques, que vous pouvez découvrir ici. Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer une plante, quelle qu’elle soit.
Pour apprendre à cueillir 6 plantes sauvages faciles à trouver et à identifier, découvrez notre newsletter gratuite.
Pour en savoir plus sur les plantes citées, vous pouvez consulter nos vidéos Youtube.
Et pour vous lancer dans des formations en ligne sérieuses et pédagogiques sur ces sujets, rendez-vous sur la page de nos formations. Vous pouvez tester nos plateformes au travers de la démo de la formation du cueilleur. L’inscription est gratuite !