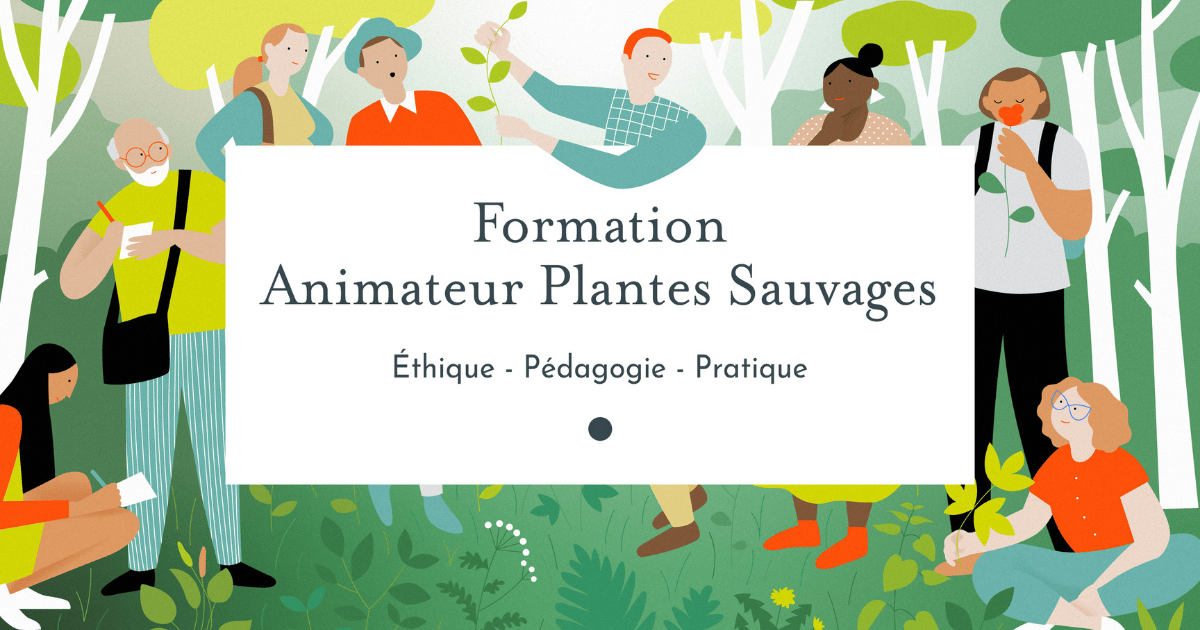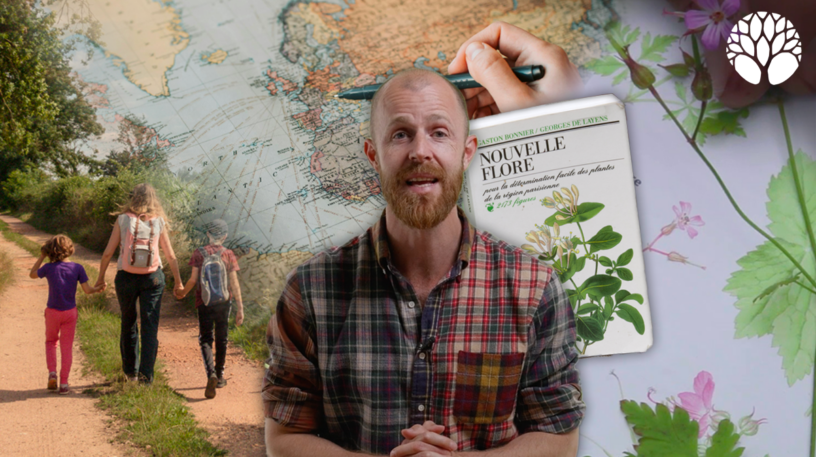,Dans le monde de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement, savoir reconnaître les plantes et les champignons est essentiel… mais savoir les transmettre l’est tout autant.
En attendant le lancement officiel de notre prochaine Formation en ligne « animateur plantes sauvages », nous partageons à travers la vidéo ci-dessous l’expérience accumulée depuis plus de 15 ans au Chemin de la Nature, avec des astuces concrètes et des éclairages pédagogiques pour mieux enseigner en pleine nature.
L’article qui suit synthétise les grands principes évoqués dans cette vidéo et les enrichit grâce aux apports des sciences de l’éducation. Que vous soyez animateur·rice, formateur·rice, ou tout simplement passionné·e par la transmission du savoir, ces éléments vous aideront à rendre vos animations plus claires, plus impactantes, et plus mémorables.
Éveiller l’attention pour faire naître l’apprentissage
Le rôle principal de l’animateur nature est de partager des connaissances et d’éveiller l’attention du public à celles-ci. Autrement dit, il propose une éducation axée sur un savoir et un savoir-faire liés à l’environnement non-humain.
La présence de l’enseignant (quelle que soit sa qualité) ou l’acte de transmission ou encore l’accès aux connaissances, ne suffisent pas à mettre en place l’apprentissage : pour qu’un apprenant (terme plus général qu’élève ou étudiant) apprenne, il faut que celui-ci se mette en situation d’apprentissage.
Ainsi, pour apprendre intentionnellement sur un sujet, il faut vouloir apprendre, mais aussi savoir apprendre et enfin pouvoir apprendre. Le « vouloir apprendre » est souvent lié à une certaine humilité : pour apprendre intentionnellement il faut d’abord reconnaître que l’on ne sait pas.¹
La pédagogie et les stratégies d’apprentissage
Voyons deux idées reçues, parmi d’autres, à dépasser sur l’apprentissage :
- Non, chacun n’a pas son “style d’apprentissage” fixe. Ce n’est pas parce qu’une personne préfère lire ou écouter qu’elle apprendra mieux de cette façon. L’efficacité dépend avant tout du sujet à apprendre, pas du type d’apprenant.³
- Relire plusieurs fois une information ne garantit ni compréhension ni mémorisation durable. D’autres méthodes sont bien plus efficaces, comme celles que nous détaillons plus bas.³,⁴
Pour l’enseignant, on distingue souvent deux modèles d’apprentissage :
-
L’apprentissage traditionnel, où l’enseignant est le principal détenteur du savoir et le transmet aux apprenants de manière unidirectionnelle ;
-
L’apprentissage par résolution de problèmes, où l’apprenant prend une part active dans la construction de son savoir.²
Ces deux approches sont parfaitement complémentaires et, selon les contextes, peuvent être tout à fait efficaces !
Parmi les stratégies d’apprentissage qui suivent et qui font consensus en sciences de l’éducation, il faut avant tout retenir qu’il n’en existe pas une qui soit meilleure que les autres, tout dépend du contexte.
Le partage : connaître son public
Pour partager efficacement une connaissance, il ne suffit pas de la transmettre : il faut l’adapter à la personne qui apprend⁵. Cela nécessite de bien connaître l’apprenant, ses besoins, son niveau, et ses différences par rapport à l’enseignant¹,⁵. Cette compréhension mutuelle permet un meilleur échange, une personnalisation de l’enseignement et instaure une confiance réciproque.
L’attention portée par l’enseignant au sujet influence aussi celle de l’apprenant⁶. Même si certains contextes compliquent cette approche, il est essentiel de s’adapter, par exemple en tenant compte de l’âge, du niveau ou de l’expérience des apprenants, afin d’éviter de sous-estimer le temps d’apprentissage nécessaire.³
Proposer des difficultés désirables
En pédagogie, on reconnaît qu’un apprentissage impliquant un léger effort permet une meilleure rétention qu’un apprentissage trop facile. Toutefois, un niveau de difficulté trop élevé peut décourager. Il faut donc viser une « difficulté désirable » : un défi accessible avec un petit effort, qui favorise l’engagement tout en préservant le sentiment de compétence.³
Cognitivement, deux systèmes sont à l’œuvre ⁷ :
- le système 1, rapide et intuitif,
-
le système 2, lent et réfléchi, nécessaire pour l’apprentissage en profondeur.
L’enjeu est de rester dans le système 2 durant l’apprentissage, jusqu’à ce que les connaissances deviennent automatiques et passent dans le système 1.¹,³
La remémoration
La remémoration, c’est le fait d’essayer de se rappeler activement une information, par exemple à travers un quiz ou une question. C’est une méthode très efficace pour renforcer la mémoire à long terme, surtout si elle se rapproche de la situation réelle d’utilisation du savoir.³
Elle peut être proposée par l’enseignant ou réalisée en auto-évaluation.¹ Elle permet de mieux ancrer les connaissances, de repérer ses lacunes et d’ajuster l’apprentissage. En botanique, se poser des questions en observant des plantes est une excellente façon de pratiquer la remémoration au quotidien.
Faire une place à l’erreur et au retour d’information
L’erreur fait partie intégrante de l’apprentissage, même si elle est souvent perçue négativement. Corriger ses erreurs, avec un retour d’information clair et réfléchi, renforce la compréhension et la mémorisation. Un petit délai avant la correction peut même favoriser l’effort de réflexion.¹,⁸,³,⁹,¹⁰,¹¹,¹²
De plus, commettre des erreurs avant d’obtenir la bonne réponse aide à mieux retenir.³. Pour l’enseignant, les erreurs des apprenants sont utiles pour adapter son enseignement⁸. Accepter l’erreur, c’est encourager l’engagement et l’apprentissage.³
Tester avant d’expliquer : la pré-évaluation
La pré-évaluation, le fait de se tester sur une connaissance avant même l’apprentissage, peut paraître contre-intuitive puisque les réponses ont de grandes chances d’être mauvaises. Mais le fait de rencontrer les bonnes réponses par la suite, au cours de l’enseignement, crée un retour d’information avec délai et une remémoration qui renforce l’apprentissage³,¹³,¹⁴.
Par exemple, essayer de décrire une plante avec ses propres mots avant même de connaître le vocabulaire botanique peut renforcer l’apprentissage de ce vocabulaire une fois présenté.
Réviser au bon moment : la répétition espacée
L’apprentissage demande du temps, et espacer les révisions est plus efficace qu’un travail intensif en une seule fois¹,¹⁰,¹²,¹⁵,¹⁶,¹⁷. Ce léger oubli entre les séances crée un effort de remémoration qui renforce la mémorisation à long terme
C’est une difficulté désirable : l’apprentissage paraît plus lent, mais il est plus durable. L’intervalle idéal dépend de chacun, mais il vaut mieux répéter juste avant d’oublier.³,¹⁷,¹⁸
Alterner les angles d’approche : l’entremêlement
L’entremêlement consiste à alterner les sujets d’apprentissage et à varier les angles d’approche d’un même thème. Cette méthode, bien que plus exigeante, favorise une meilleure mémorisation à long terme que l’étude répétitive et linéaire¹,³,¹⁹.
Elle stimule la remémoration active et offre une vision plus globale du sujet.³
En botanique, cela peut consister à alterner les espèces et les familles, ou à observer une plante sous différents aspects : feuilles, fleurs, usages, etc.
Synthétiser et élaborer
La synthèse et l’élaboration sont deux stratégies clés pour un apprentissage efficace. Elles consistent à extraire les idées essentielles, les relier entre elles et les connecter à ses connaissances antérieures, afin de construire un cadre mental cohérent qu’on peut reformuler avec ses propres mots.³
Cette approche aide à mieux comprendre et mémoriser, en transformant un ensemble d’infos en un schéma clair.
Par exemple, reconnaître une plante au premier regard vient d’une représentation mentale stable, construite par l’expérience et la réflexion. Pour l’animateur, varier ses explications renforce aussi sa propre compréhension.
Pratiquer la réflexion ou la métacognition
La réflexion, ou métacognition, consiste à se questionner sur ce qu’on a fait, compris ou raté, et sur ce qu’on pourrait améliorer.
Cette pratique renforce la mémorisation à long terme et développe l’autonomie des apprenants. Elle mêle remémoration (ce qui s’est passé) et élaboration (ce qu’on pourrait faire autrement).¹,³,²⁰,²¹
Par exemple, après avoir cueilli des plantes pour une salade, réfléchir à ce qu’on a utilisé, pourquoi, et comment améliorer la recette la prochaine fois, permet d’ancrer les apprentissages.
Pour aller plus loin
Nous vous rappelons que la cueillette sauvage comporte des risques, que vous pouvez découvrir ici. Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer une plante, quelle qu’elle soit.
Pour apprendre à cueillir 6 plantes sauvages faciles à trouver et à identifier, découvrez notre newsletter gratuite.
Pour en savoir plus sur les plantes citées, vous pouvez consulter nos vidéos Youtube.
Et pour vous lancer dans des formations en ligne sérieuses et pédagogiques sur ces sujets, rendez-vous sur la page de nos formations. Vous pouvez tester nos plateformes au travers de la démo de la formation du cueilleur. L’inscription est gratuite !
Et si c’était votre tour de partager votre savoir sur les plantes sauvages ?
Découvrez notre nouvelle formation pour vous apprendre à guider, animer et transmettre vos connaissances sur les plantes sauvages, de manière vivante et sécurisée.
🎓 La formation « Animateur Plantes Sauvages » : pour celles et ceux qui veulent passer de l’apprentissage à la transmission … et devenir des passeurs de nature.
👉 Profitez dès maintenant des préventes à -50 % jusqu’au 22 juin !
Sources
- Carré, P. Pourquoi et comment les adultes apprennent. De la formation à l’apprenance. Dunod (2020).
- Khalaf, B. K. & Zin, Z. B. M. Traditional and Inquiry-Based Learning Pedagogy: A Systematic Critical Review. Int. J. Instr. 11, 545‑564 (2018).
- Brown, P. C., Roediger, H. L., McDaniel, M. A. & Pasquinelli, E. Mets-toi ça dans la tête ! Les stratégies d’apprentissage à la lumière des sciences cognitives. markus haller (2016).
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R. Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychol. Sci. Public Interest. 9, 105‑119 (2008).
- Ingold, T. L’anthropologie comme éducation. Presses Universitaires de Rennes (2018).
- Citton, yves. Sciences de l’éducation ou arts de l’attention ? in Anthropol. Comme Éducation. Presses Universitaires de Rennes (2018).
- Kannengiesser, U. & Gero, J. S. Empirical Evidence for Kahneman’s System 1 and System 2 Thinking in Design. Hum. Behav. Des. (2019).
- Metcalfe, J. Learning from Errors. Annu. Rev. Psychol. 68, 465‑489 (2017).
- Castel, A. D., Vendetti, M. & Holyoak, K. J. Fire drill: Inattentional blindness and amnesia for the location of fire extinguishers. Atten. Percept. Psychophys. 74, 1391‑1396 (2012).
- Yang, C., Luo, L., Vadillo, M. A., Yu, R. & Shanks, D. R. Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review. Psychol. Bull. 147, 399‑435 (2021).
- Arnold, K. M. & McDermott, K. B. Test-potentiated learning: Distinguishing between direct and indirect effects of tests. J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cogn. 39, 940‑945 (2013).
- Butler, A. C., Karpicke, J. D. & Roediger III, H. L. The effect of type and timing of feedback on learning from multiple-choice tests. J. Exp. Psychol. Appl. 13, 273‑281 (2007).
- Roediger III, H. L., Putnam, A. L. & Smith, M. A. Ten Benefits of Testing and Their Applications to Educational Practice. in Psychol. Learn. Motiv. vol. 55 Academic Press (2011).
- Richland, L. E., Kornell, N. & Kao, L. S. The pretesting effect: Do unsuccessful retrieval attempts enhance learning?. J. Exp. Psychol. Appl. 15, 243‑257 (2009).
- Benjamin, A. S. & Tullis, J. What makes distributed practice effective?. Cognit. Psychol. 61, 228‑247 (2010).
- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T. & Rohrer, D. Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychol. Bull. 132, 354‑380 (2006).
- Lindsey, R. V., Shroyer, J. D., Pashler, H. & Mozer, M. C. Improving Students’ Long-Term Knowledge Retention Through Personalized Review. Psychol. Sci. 25, 639‑647 (2014).
- Soderstrom, N. C. & Bjork, R. A. Learning Versus Performance: An Integrative Review. Perspect. Psychol. Sci. 10, 176‑199 (2015).
- Birnbaum, M. S., Kornell, N., Bjork, E. L. & Bjork, R. A. Why interleaving enhances inductive learning: The roles of discrimination and retrieval. Mem. Cognit. 41, 392‑402 (2013).
- Mahdavi, M. An overview: Metacognition in education. Int. J. Multidiscip. Curr. Res. 2, 529‑535 (2014).
- Perry, J., Lundie ,David & and Golder, G. Metacognition in schools: what does the literature suggest about the effectiveness of teaching metacognition in schools?. Educ. Rev. 71, 483‑500 (2019).