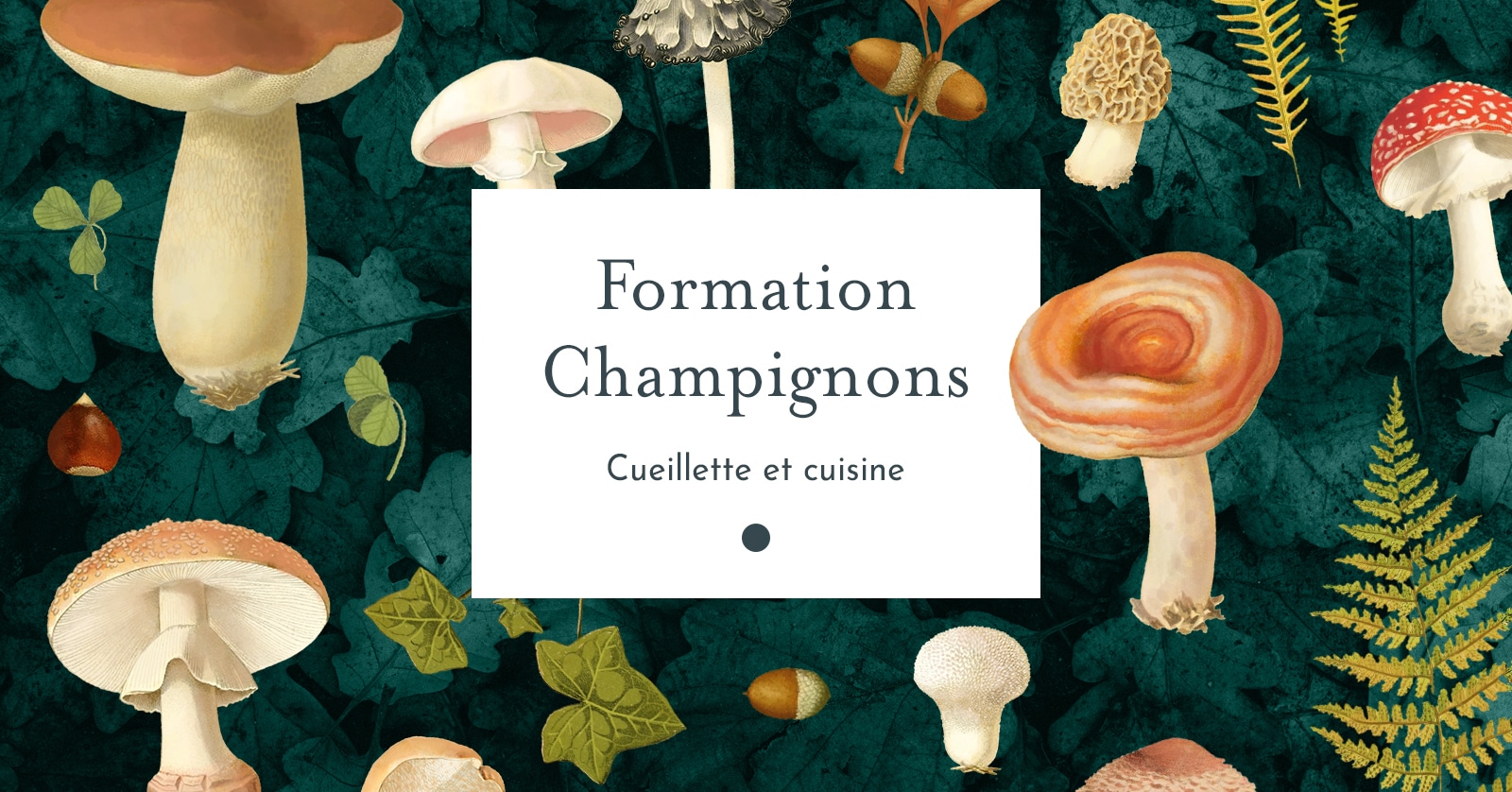La mycène rose (Mycena rosea) est un champignon fréquent des forêts de feuillus. Il est généralement considéré comme toxique et on entend parfois qu’il serait hallucinogène. Voyons ensemble ce qu’on peut en dire aujourd’hui. (Sources à la fin de l’article)
Présentation de la mycène rose
La mycène rose (on dit aussi parfois le mycène) est un champignon surtout saprotrophe, c’est-à-dire qu’il consomme des matières organiques mortes comme des feuilles mortes. Elle semble parfois pouvoir être mycorhizienne dans certaines conditions¹. On la trouve surtout à l’automne, dans les forêts de feuillus, particulièrement dans les forêts de hêtres.
Identification
On la reconnaît à son chapeau rose qui se décolore souvent vers le centre, à son pied blanchâtre à rose pâle, à son odeur nette de radis. La mycène rose a donc une couleur et une odeur de radis ! On trouve des lames rose pâle sous le chapeau. Son chapeau est un peu mamelonné²-⁴.
La toxicité de la mycène rose
Une espèce proche de la mycène pure
Historiquement, la mycène rose était considérée comme une variété de la mycène pure (Mycena pura). La séparation de ces deux espèces semble aujourd’hui bien admise mais il reste qu’elles sont génétiquement très proches⁵,⁶. Il est donc très probable que la toxicité de la mycène rose soit très proche de celle de la mycène pure, ce que nous prenons en compte pour la suite.
Évolution de sa réputation
La mycène rose a été décrite comme comestible pendant longtemps⁷-¹⁰. Mais elle a tout de même été suspectée d’être toxique dès le début du XXème siècle¹¹,¹². Elle est aujourd’hui le plus souvent considérée comme toxique²,³,¹³.
Sa composition chimique
La mycène rose contient ou est susceptible de contenir seulement une faible quantité de muscarine¹⁴,¹⁵. De plus, cette muscarine pourrait être en grande partie sous une forme (isomère) moins active¹⁵.
Les effets possibles
La muscarine, lorsqu’elle est consommée en assez grande quantité, produit un syndrome muscarinien au bout de 15 minutes à 2 heures et qui se manifeste notamment par une sudation importante, une diminution de la taille des pupilles et des troubles gastro-intestinaux (vomissements, diarrhées, etc.)³,¹⁶. Les cas d’intoxication par les mycènes roses ou pures sont très rares voire absents dans les études des 30 dernières années¹⁷-²³, et se limitent à des troubles gastro-intestinaux²³, ce qui ne correspond pas au syndrome muscarinien.
Hallucinations : mythe ou réalité ?
De rares cas d’hallucinations existent pour la mycène pure, dont un cas qui aurait entraîné des troubles psychologiques pendant plusieurs mois²⁴, mais ces cas sont antérieurs aux années 1990 et difficilement attribuables à la bonne espèce. Enfin, la mycène rose ne contient pas de psilocybine ou de molécules proches, connues pour être hallucinogènes²⁵.
Conclusion : la mycène rose est-elle hallucinogène ?
Au final, on peut conclure que la mycène rose n’est probablement pas hallucinogène comme cela a déjà été dit ailleurs²⁵,²⁶. Elle ne provoque probablement pas non plus de syndrome muscarinien, comme cela a aussi déjà été dit ailleurs²³. En revanche, elle est susceptible de provoquer des troubles gastro-intestinaux. Nous déconseillons sa consommation.
FAQ – Questions fréquentes sur la mycène rose
La mycène rose est-elle comestible ?
Non. Elle est considérée comme toxique.
La mycène rose est-elle hallucinogène ?
Non. Elle ne contient pas de psilocybine et ne provoque pas d’effets hallucinogènes connus.
Quels sont les symptômes en cas d’intoxication ?
Principalement des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées).
Quelle est la différence entre la mycène rose et la mycène pure ?
Pour aller plus loin
Nous vous rappelons que la cueillette sauvage des champignons comporte des risques. Vous pouvez découvrir ici les règles et précautions pour la cueillette.
Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer un champignon, quel qu’il soit.
Envie d’en savoir plus sur l’univers fascinant des champignons ? Inscrivez-vous à notre formation gratuite en 6 mails, pour balayer les idées reçues sur les champignons !
Pour en savoir plus sur les champignons cités, vous pouvez consulter nos vidéos Youtube.
Pour vous lancer dans des formations en ligne sérieuses et pédagogiques sur ces sujets, rendez-vous sur la page de nos formations en ligne sur les plantes sauvages et les champignons.
Vous pouvez aussi apprendre et pratiquer sur le terrain avec nos guides mycologues en nous rejoignant lors de nos stages de 2 jours.
Sources
- Harder, C. B. et al. Mycena species can be opportunist-generalist plant root invaders. Environ. Microbiol. 1‑19 (2023).
- Eyssartier, G. & Roux, P. Guide des champignons France et Europe. Belin (2024).
- Courtecuisse, R., Duhem, B. & Vincenot, P. Champignons de France et d’Europe. Delachaux (2024).
- Kibby, G. Mushrooms and toadstools of Britain & Europe Volume 2 Agarics – part 1. Geoffrey Kibby (2020).
- Cortés-Pérez, A. et al. New Species of Bioluminescent Mycena Sect. Calodontes (Agaricales, Mycenaceae) from Mexico. J. Fungi. 9, 902 (2023).
- Nagamune, K. et al. Two new Mycena section Calodontes species: One newly discovered and the other new to Japan. Mycoscience. 65, 111‑122 (2024).
- Delisle Hay, W. An Elementary Text-book of British Fungi. Swan Sonnenschein, Lowrey & co. (1887).
- Cordier, F.-S. Les champignons : histoire, description, culture, usages des espèces comestibles, vénéneuses, suspectes employées dans les arts, l’industrie, l’économie domestique, la médecine. J. Rothschild (1876).
- Romagnesi, H. Champignons d’Europe. Bordas (1977).
- Maublanc, A. & Viennot-Bourgin, G. Champignons de France. vol. 2 Paul Lechevalier (1959).
- Rolland, L. Atlas des champignons de France, Suisse et Belgique. Paul Klincksieck (1910).
- Costantin, J. Atlas des champignons comestibles et vénéneux. Librairie générale de l’enseignement (1926).
- Gerber, J.-C. & Schwab, N. Champignons. Guide de terrain. VAPKO (2021).
- Dann, G. Edible Mushrooms: A Forager’s Guide to the Wild Fungi of Britain, Ireland and Europe. Green Books (2016).
- Stadelmann, R. J., Eugster, C. H. & Müller, E. Über die Verbreitung der stereomeren Muscarine innerhalb der Ordnung der Agaricales. Helv. Chim. Acta. 59, 2432‑2436 (1976).
- White, J. et al. Mushroom poisoning: A proposed new clinical classification. Toxicon. 157, 53‑65 (2019).
- Keller, S. A. et al. Mushroom Poisoning—A 17 Year Retrospective Study at a Level I University Emergency Department in Switzerland. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 15, 2855 (2018).
- Brandenburg, W. E. & Ward, K. J. Mushroom poisoning epidemiology in the United States. Mycologia. 110, 637‑641 (2018).
- Cervellin, G. et al. Epidemiology and clinics of mushroom poisoning in Northern Italy: A 21-year retrospective analysis. Hum. Exp. Toxicol. 37, 697‑703 (2018).
- Pennisi, L., Lepore, A., Gagliano-Candela, R., Santacroce, L. & Charitos, I. A. A Report on Mushrooms Poisonings in 2018 at the Apulian Regional Poison Center. Open Access Maced. J. Med. Sci. 8, 612‑622 (2020).
- Beug, W., Shaw, M. & Cochran, K. W. Thirty plus years of mushroom poisoning: summary of the approximately 2,000 reports in the NAMA case registry. (2006).
- Cassidy, N., Duggan, E. & Tracey, J. A. Mushroom poisoning in Ireland: The collaboration between the National Poisons Information Centre and expert mycologists. Clin. Toxicol. 49, 171‑176 (2011).
- Sitta, N., Davoli, P., Floriano, M. & Suriano, E. Guida ragionata alla commestibilità dei funghi. Regione Piemonte (2021).
- Samorini, G. Funghi allucinogeni italiani. Ann. Mus. Civ. Rovereto. 8, 125‑149 (1993).
- Courtecuisse, R. & Deveaux, M. Champignons hallucinogènes d’Europe et des Amériques : mise au point mycologique et toxicologique. Ann. Toxicol. Anal. 16, 36‑64 (2004).
- Samorini, G. Sullo stato attuale della conoscenza dei Basidiomiceti psicotropi italiani. Ann Mus Civ Rovereto. 5, 167‑184 (1989).